



Le
goût
Le goût est l’un de nos cinq sens, avec le toucher, l’ouïe, l’odorat et la vue. Depuis très longtemps, on s’accorde à reconnaître aux organes gustatifs la capacité de discerner quatre saveurs élémentaires : le salé, le sucré, l’acide et l’amer. La gustation est un registre sensoriel qui fonctionne avec l’olfaction.
I Les organes du goût
Les
cellules réceptrices du goût sont situées principalement à la surface de la
langue dans des papilles. La langue est un organe médian et symétrique
qui occupe la partie moyenne du plancher buccal et fait saillie dans la bouche,
ou cavité buccale. Chez l’homme, elle a la forme d’un cône, dont
la pointe, légèrement aplatie, est inclinée vers le bas. Sur sa face inférieure,
une crête médiane se prolonge vers l’arrière par un repli muqueux, le filet
ou frein, qui la fixe à la bouche.
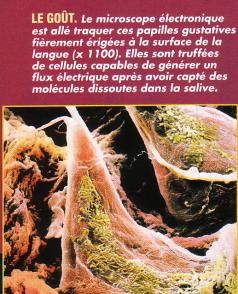 A la partie postérieure, s’ouvre l’orifice du canal
de Wharton des glandes salivaires sous-maxillaires. Sa face supérieure, plane,
est marquée par le sillon médian, axe de la symétrie linguale. Sa surface
est rendue irrégulière par la présence de papilles gustatives. Enfin, la langue
est mue par dix-sept muscles striés, dont un seul, le muscle intrinsèque, est
situé intégralement dans la langue, tandis que les autres sont rattachés aux
cartilages et aux os de la région céphalique (région de la tête).
A la partie postérieure, s’ouvre l’orifice du canal
de Wharton des glandes salivaires sous-maxillaires. Sa face supérieure, plane,
est marquée par le sillon médian, axe de la symétrie linguale. Sa surface
est rendue irrégulière par la présence de papilles gustatives. Enfin, la langue
est mue par dix-sept muscles striés, dont un seul, le muscle intrinsèque, est
situé intégralement dans la langue, tandis que les autres sont rattachés aux
cartilages et aux os de la région céphalique (région de la tête).
La langue est recouverte d’une muqueuse,
membrane qui tapisse l’intérieur des organes creux communiquant directement
avec l’extérieur et qui sécrète du mucus, constituée d’un épithélium,
membrane ou tissu formé de cellules juxtaposées, et d’un derme, partie
profonde de la peau, située sous l’épiderme, formée de tissu conjonctif et contenant
des vaisseaux, des nerfs et les follicules pileux, plus ou moins épais selon
les régions.
Sur
la face supérieure, les papilles qui hérissent la muqueuse sont réparties en
cinq groupes : les hémisphériques, les papilles foliées, les filiformes,
les caliciformes et les fongiformes. Seuls les deux derniers types
renferment des bourgeons du goût, les papilles filiformes ne possédant que des
terminaisons tactiles.
Les bourgeons du goût, localisés à l’intérieur de la muqueuse, sont constitués de cellules en contact avec le milieu extérieur par l’intermédiaire d’un pore, la fossette gustative. Ils ont globalement la forme d’un oignon et mesurent environ 80 µm de hauteur et 40 µm de diamètre. On en dénombre environ 800 dans les papilles caliciformes. Un bourgeon est formé de cellules sensorielles et de cellules de soutien, situées à la périphérie et au centre du bourgeon. Les cellules gustatives, qui portent les récepteurs sont au nombre de 4 à 10 par bourgeon. De forme allongée, ces dernières sont terminées par des microvillosités, appelées cils gustatifs, qui pénètrent la fosse gustative et portent les récepteurs gustatifs proprement dits. De nombreuses cellules nerveuses sont réparties autour des cellules gustatives et de soutien.

II Physiologie du goût
La classification des saveurs
perçues ne retient que quatre catégories : le salé, le
sucré, l’acide et l’amer car les autres saveurs de base ont été
composées à partir de ces quatre saveurs primaires. Les papilles
sensibles aux saveurs primaires sont disposées sur la langue de façon
spécifique pour chacune : la zone de l’amer est située sur la
partie postérieure de la langue, la zone du sucré, sur la partie
antérieure, les zones de l’acide et du salé sont localisées
sur les bords, vers l’arrière pour les premières et vers l’avant
pour les secondes. La partie centrale de la langue et sa face inférieure
ne réagissent à aucune saveur. On estime que le palais perçoit
l’amer et l’acide ; cette dernière saveur peut également être
détectée par d’autres territoires : gencives, joues, lèvres…
de la cavité buccale.

Pour pouvoir être « goûtée », une substance doit impérativement être soluble et dissoute dans la salive. Il est donc indispensable que la valeur d’humidité de la bouche et de la langue soit optimale, ce qui n’est possible que lorsque la température, qui joue un rôle non négligeable, se situe entre 25 et 40°C. Pour toutes les autres températures, les sensations thermiques prennent le pas sur les gustatives. La substance à goûter doit également séjourner pendant un minimum de temps sur la langue pour donner naissance à une saveur. Ainsi les goûteurs font-ils circuler longuement dans leur bouche l’aliment ou le liquide testé afin d’imprégner le plus de surface gustative possible.
![]()
Il faut ensuite que la substance soit en concentration
suffisamment importante : le seuil de sensibilité est différent
selon chaque espèce. Les sensations générées par les substances sapides ne sont
pas systématiquement en relation avec leur pouvoir nutritif réel : la saccharine
apporte très peu de calories par rapport aux sucres qu’elle remplace, tout en
provoquant une sensation sucrée plus importante.
III Les centres nerveux du goût
A la différence des autres modalités sensorielles,
il n’existe pas de voies nerveuses spécifiques pour le goût. Les fibres sensitives
partent des bourgeons situés dans les papilles de la langue et cheminent, avec
les fibres du tact ou de la température, vers la 5ème branche du
nerf crânien, le trijumeau. Elles se dirigent ensuite vers le nerf de
la corde du tympan et entrent dans le cerveau par le 7ème nerf crânien,
le facial. D’autres fibres gustatives rejoignent l’encéphale par les
9ème et 10ème nerfs crâniens.
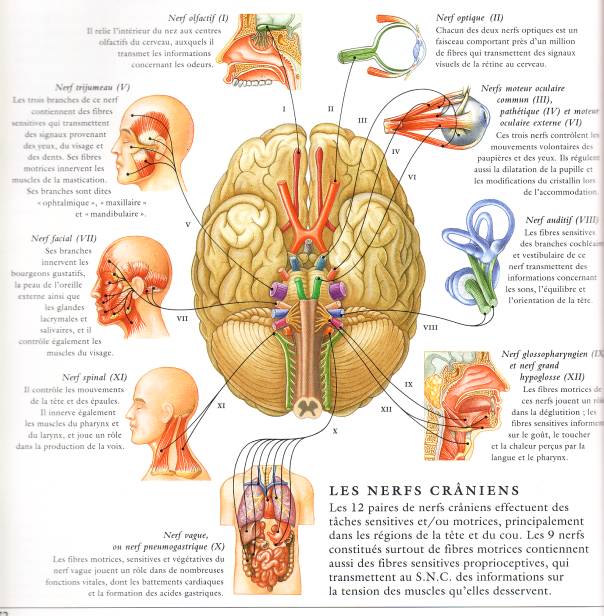
Dans les noyaux centraux correspondant à chacun
de ces nerfs, les fibres gustatives établissent une première connexion avec
un neurone. Les neurones véhiculant la sensibilité gustative projettent
à leur tour leur axone vers le noyau gustatif du bulbe, où toutes les informations
concernant le goût sont regroupées. Les connexions suivantes deviennent de plus
en plus complexes et font notamment intervenir les centres émotionnels du cerveau.
Un ensemble de fibres parvient au niveau du cortex, à la hauteur du lobe pariétal ;
cette aire corticale, qui reçoit toutes les informations venues de la langue,
est particulièrement étendue en comparaison de celle de chacune des autres parties
du corps.
Comme pour toutes les sensibilités, la perception
des saveurs, qu’elles soient agréables ou désagréables, varie considérablement,
selon les individus. Le fait que le goût soit directement impliqué dans le comportement
alimentaire rend les choses plus évidentes encore. L’appétence, l’attirance
pour certains aliments, est simplement guidée par des traditions culinaires,
les organes du goût ont donc été détournés de leur vocation première :
nous aider à sélectionner les aliments dont nous avons besoin.